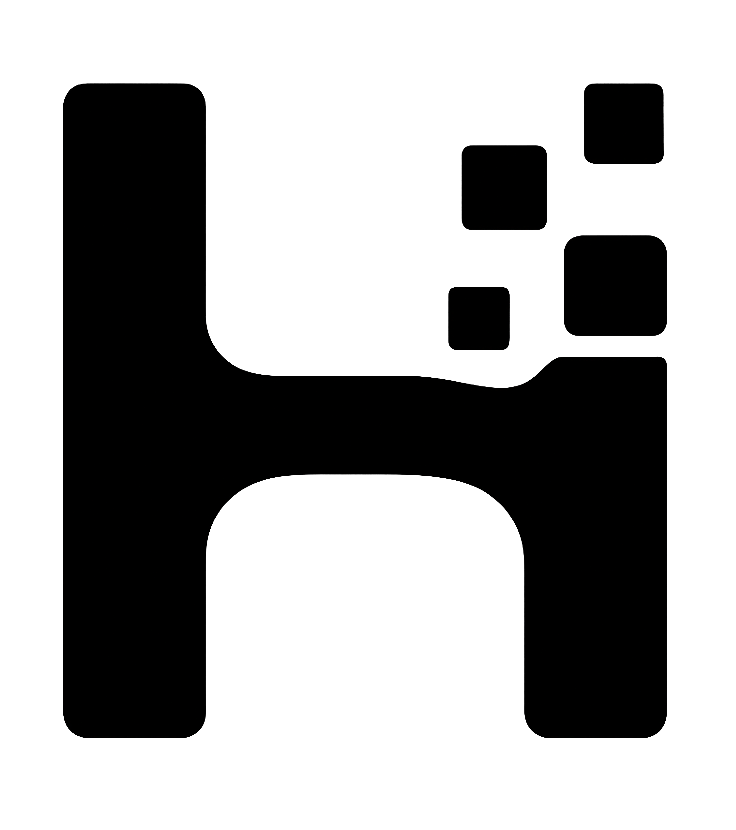Le vieillissement démographique n’est pas qu’un enjeu sociétal, c’est aussi un défi macro-économique. Une population qui vieillit affecte la main-d’œuvre disponible, la croissance de la productivité, ainsi que les dépenses publiques (retraites, santé, dépendance). Dans cette partie, nous examinons tour à tour : (a) la question de l’emploi des seniors et de la participation au marché du travail, (b) l’impact du vieillissement sur la productivité et l’innovation, (c) les effets sur les finances publiques et le système de protection sociale. Nous nous appuyons sur des recherches académiques (FMI, OCDE, etc.), des rapports de think tanks et des données empiriques pour éclairer ces enjeux. Nous mettrons en avant les politiques publiques menées ou envisagées pour mitiger les effets négatifs (réforme des retraites, formation tout au long de la vie, etc.), en discutant leurs avantages et leurs limites.
Emploi des seniors : des marges de progression importantes
L’un des leviers pour faire face au vieillissement est d’augmenter le taux d’emploi des 55-64 ans, afin de compenser en partie la diminution de la population en âge de travailler. De nombreux pays développés ont amélioré l’emploi des seniors depuis 20 ans, souvent en reculant l’âge de la retraite et en luttant contre la préretraite.
En Europe, le taux d’emploi moyen des 55-64 ans est passé de 38 % en 2000 à environ 60,5 % en 2021. Il existe toutefois de fortes disparités entre pays. Les pays scandinaves et anglo-saxons enregistrent les meilleures performances : en Suède, le taux d’emploi des 55-64 ans atteignait 77,3 % en 2022 (record de l’UE), grâce à un marché du travail inclusif et un âge de départ à la retraite flexible (autour de 65-67 ans). Le Danemark et l’Estonie dépassent aussi 70 %. L’Allemagne a connu une progression spectaculaire : d’environ 40 % au début des années 2000 à 71,8 % en 2021insee.fr, à la faveur des réformes Hartz et du relèvement progressif de l’âge de la retraite (65 à 67 ans). À l’inverse, la France est en retard dans l’emploi des seniors, malgré une amélioration récente. En 2021, le taux d’emploi des 55-64 ans en France était de 55,9 %, bien en dessous de la moyenne européenne. Plus frappant, pour la tranche 60-64 ans, la France n’affichait qu’environ 34 % d’actifs en 2019, contre 47 % en Allemagne et plus de 60 % en Suède. Cela s’explique par un âge de départ effectif à la retraite encore bas (62 ans) et des dispositifs de sortie précoce du marché du travail (préretraites, minima sociaux).
Conséquences économiques : Une faible participation des seniors accentue l’impact du vieillissement sur la pénurie de main-d’œuvre et sur la croissance potentielle. Moins de travailleurs signifie potentiellement moins de PIB et moins de cotisations sociales pour financer les retraites. À l’extrême, si la durée de vie s’allonge mais que la durée de vie active ne suit pas, on accroît considérablement la charge sur les actifs restants (ce qu’illustre le ratio de dépendance). L’OCDE estime qu’une hausse de 1 point du taux d’emploi des 55-64 ans peut atténuer significativement (jusqu’à 0,5 point) l’augmentation du ratio de dépendance.
Politiques publiques : Pour remédier à cela, la plupart des pays ont entamé des réformes des retraites visant à prolonger la vie active (âge légal reculé à 65, 66, 67 ans selon les pays). La France, par exemple, vient de voter le passage de 62 à 64 ans de l’âge légal d’ici 2030, afin d’augmenter le taux d’emploi des 60-64 ans. Parallèlement, des politiques d’adaptation du travail aux seniors sont cruciales : formation continue, aménagements de fin de carrière (temps partiel progressif, pénibilité prise en compte). Un rapport de l’OCDE (2020) souligne que la formation des travailleurs âgés reste un point faible : en moyenne OCDE, seuls 20 % des 55-64 ans participent à des programmes de formation, contre près de 40 % des 25-34 ans. Or l’adaptation des compétences est clé pour maintenir l’employabilité des seniors, surtout avec la digitalisation de l’économie. Certains pays, comme le Danemark ou les Pays-Bas, ont mis en place des comptes de formation tout au long de la vie et incitent fortement les entreprises à former leurs salariés âgés (sous peine de contributions financières).
Cas particulier du Japon : Face à une contraction extrême de sa population active, le Japon encourage activement l’emploi au-delà de 65 ans. L’âge effectif moyen de sortie du marché du travail y est déjà l’un des plus élevés (près de 67 ans). Des entreprises expérimentent le maintien en poste jusqu’à 70 ans, et les normes sociales valorisent de plus en plus les “seniors actifs”. Cela atténue la chute du nombre de travailleurs, mais pose d’autres questions en termes de productivité individuelle (voir section suivante).
En résumé, favoriser l’emploi des seniors est un impératif pour amortir le choc du vieillissement. Les politiques menées (retraites, lutte contre la discrimination par l’âge, formation) ont montré des résultats là où elles ont été ambitieuses (ex : pays nordiques, Allemagne). La France et certains pays latins accusent encore du retard, mais les réformes récentes pourraient améliorer la situation d’ici 2030. Il reste toutefois des limites biologiques et sociétales : tout le monde ne peut ou ne souhaite pas travailler jusqu’à 67 ans, surtout dans des métiers pénibles. Le débat sur l’équilibre entre qualité de vie et exigences économiques reste ouvert.
Productivité et croissance : l’impact d’une population vieillissante
Un enjeu plus subtil est celui de la productivité économique dans une société vieillissante. La question posée est : une population plus âgée est-elle moins dynamique et innovante, entraînant un ralentissement de la croissance de la productivité ? Les recherches sur ce sujet offrent des conclusions nuancées.
Effet du vieillissement sur la croissance potentielle : Une étude du FMI (2017) a montré que le vieillissement de la population active en zone euro a déjà réduit la croissance de la productivité globale des facteurs (PGF) d’environ 0,1 point par an en moyenne sur les deux décennies précédant 2014. Ce même exercice projette que, compte tenu des projections démographiques, la croissance annuelle moyenne de la PGF pourrait être amputée de 0,2 point par an entre 2014 et 2035 du fait du vieillissement. Dit autrement, chaque année la population vieillit, la progression de l’efficacité économique se fait un peu moins rapide qu’elle ne l’aurait été avec une structure d’âge plus jeune. Sur longue période, cet effet cumulé peut représenter plusieurs points de PIB.
Les canaux explicatifs sont multiples : moindre renouvellement des travailleurs (les jeunes générations arrivant avec des compétences plus à jour étant moins nombreuses), moindre diffusion des innovations (les entreprises composées d’une main-d’œuvre plus âgée adoptent parfois plus lentement les nouvelles technologies), ou encore changements sectoriels (une population âgée consomme plus de services de santé et moins de biens de consommation, or les gains de productivité sont historiquement plus faibles dans les services que dans l’industrie). Une étude de la Banque Mondiale (2016) note par exemple que le vieillissement tend à réorienter l’économie vers des secteurs à plus faible productivité – soins à la personne, services domestiques – au détriment de secteurs comme la construction ou l’industrie manufacturière qui traditionnellement portent la croissance de la productivité.
Productivité individuelle et âge : Au niveau microéconomique, la relation entre l’âge et la productivité du travailleur est complexe. Plusieurs études indiquent que la productivité individuelle croît jusqu’à un certain âge (40-50 ans) puis stagne ou décline légèrement ensuite. Les travailleurs seniors accumulent de l’expérience (ce qui peut maintenir une haute productivité dans des tâches routinières ou de gestion de connaissances), mais peuvent voir décliner certaines aptitudes physiques ou d’apprentissage (vitesse d’exécution, adaptation aux nouvelles technologies). Un débat académique existe : les seniors sont-ils moins innovants ? Des travaux comme ceux d’Aksoy et al. (2015) suggèrent qu’une population plus âgée dépose moins de brevets et innove moins, en partie parce que la tranche 50-59 ans, lorsqu’elle domine, serait moins encline au changement technologique. Cependant, d’autres études (Jones, 2010) nuancent en montrant que les plus fortes innovations d’une génération viennent souvent à l’âge mûr, et que ce sont plutôt les cohortes réduites des jeunes qui freinent l’innovation (moins de jeunes “génies” en proportion).
Adaptations possibles : Face à ces constats, augmenter l’emploi des seniors (vu plus haut) ne suffit pas, il faut aussi maintenir et améliorer leur productivité. Cela passe par :
- La formation continue pour que les travailleurs plus âgés maîtrisent les nouvelles compétences, notamment numériques. Par exemple, en Allemagne et Autriche, plus de 60 % des 55-64 ans avaient des compétences numériques de base en 2018, contre moins de 40 % en Italie, ce qui se reflète dans leur capacité à s’adapter.
- L’amélioration des conditions de travail pour les seniors : ergonomie, santé au travail, prévention de l’usure professionnelle, pour qu’un employé de 60 ans puisse être aussi efficient qu’à 50 ans.
- La transmission des savoirs intergénérationnelle : encourager le mentorat, l’équipes mêlant jeunes et seniors pour combiner innovation et expérience.
- L’innovation technologique elle-même peut atténuer les effets du vieillissement : la robotisation et l’IA peuvent compenser une partie du manque de main-d’œuvre ou aider les travailleurs âgés dans leurs tâches (ex : exosquelettes dans l’industrie pour réduire l’effort physique des seniors).
Cas macroéconomique du Japon : Le Japon illustre une stratégie où la technologie est mise à contribution pour contrer la baisse de productivité potentielle due au vieillissement. Le pays investit massivement dans les robots industriels et sociaux, ce qui lui a permis de maintenir une productivité élevée dans certaines industries malgré une main-d’œuvre stagnante. Néanmoins, le Japon connaît depuis les années 1990 un ralentissement de sa croissance, dû en partie à sa démographie : selon une étude de la BOJ, le vieillissement a contribué pour environ 0,3 point par an à la baisse de la croissance japonaise entre 1990 et 2015.
Synthèse des recherches : Globalement, la plupart des travaux concluent que le vieillissement exerce une pression à la baisse sur la croissance économique à long terme. Un article de Maestas et al. (2016, American Economic Review) a quantifié qu’une augmentation de 10 % de la part des plus de 60 ans dans la population réduisait la croissance du PIB par habitant de 5,5 % sur 25 ans. Toutefois, il y a des réponses politiques pour contrer cela : investir dans le capital humain (formation, santé), dans le capital technologique (automatisation), et dans des réformes structurelles (recul de l’âge de la retraite, immigration qualifiée) qui peuvent maintenir un niveau de productivité satisfaisant.
En conclusion de cette section, on peut dire que le vieillissement n’implique pas fatalement une stagnation économique, mais il oblige à adapter le modèle de croissance. Les pays vieillissants devront davantage compter sur la productivité par travailleur (via l’innovation, l’éducation) puisque le nombre de travailleurs croît peu ou décroît. C’est un changement de paradigme par rapport au XXᵉ siècle où la croissance démographique alimentait mécaniquement la croissance économique.
Finances publiques et protection sociale : une pression croissante
Le vieillissement exerce une forte pression sur les dépenses publiques, en particulier dans trois domaines : les retraites, la santé et la dépendance (soins de longue durée). Parallèlement, il peut peser sur les recettes (moins d’actifs cotisants si rien n’est fait). Les enjeux budgétaires sont donc considérables, et les choix de politique publique (réformes des systèmes de retraite, assurance dépendance, etc.) vont déterminer la soutenabilité financière face à ce choc démographique.
Dépenses de retraites : Dans les pays européens, les retraites représentent souvent le premier poste de dépenses publiques. En France, la dépense de retraite équivaut à environ 14 % du PIB en 2022 (près de 340 milliards d’euros). Avec le papy-boom et l’augmentation de l’espérance de vie, sans réformes, ce ratio aurait grimpé encore. Le Conseil d’Orientation des Retraites (COR) projette qu’en l’absence de mesures, la dépense de retraite pourrait atteindre entre 15 et 16 % du PIB dans les années 2030, avant de se stabiliser ou refluer si la génération du baby-boom disparaît (années 2050). Les réformes type allongement de la durée de cotisation et recul de l’âge légal visent justement à contenir ce ratio. Ailleurs en Europe, des pays comme l’Italie et la Grèce ont déjà des dépenses de retraite autour de 15-17 % du PIB, et risquent de dépasser 20 % d’ici 2050 si rien n’est changé (source : Commission Européenne, Ageing Report 2021). Les pays scandinaves et le Canada, ayant des régimes plus soutenables (composante par capitalisation notamment), prévoient des augmentations plus modérées.
Dépenses de santé : Une population âgée consomme davantage de soins de santé, surtout après 75-80 ans. Les dépenses de santé ont ainsi tendance à croître avec le vieillissement, bien que le progrès technique médical soit aussi un moteur (et souvent plus fort) de la hausse des coûts. Dans l’UE, les dépenses publiques de santé étaient en moyenne de 6,8 % du PIB en 2016 et pourraient monter à 7,7 % en 2070 juste sous l’effet du vieillissement. Ce chiffre modeste (moins de +1 point en 50 ans) s’explique par l’hypothèse d’un vieillissement en meilleure santé (“compression de la morbidité” – on vivrait plus longtemps mais pas beaucoup plus d’années malades). En France, les dépenses de santé (toutes sources) sont déjà plus élevées, autour de 12 % du PIB, dont une grande partie pour les seniors (les 65+ représentent ~60% des dépenses de l’Assurance Maladie). L’arrivée à des âges avancés des baby-boomers des années 1950 va mécaniquement accroître le nombre de patients atteints de maladies chroniques (diabète, cardiopathies, cancers, démences…). Les projections nationales (DREES) estiment une augmentation des dépenses de santé liées au vieillissement de +0,7 point de PIB d’ici 2030. Il faudra y ajouter le coût de la dépendance.
Dépendance et soins de longue durée : C’est le “dernier chapitre” du vieillissement : la prise en charge des personnes très âgées en perte d’autonomie. Aujourd’hui, environ 1,3 million de personnes de plus de 60 ans en France sont en situation de dépendance, partielle ou totale. En 2050, ce nombre pourrait atteindre 2 millions ou plus. Déjà, les dépenses publiques d’aide à l’autonomie (APA, foyers logement, EHPAD financés) représentent environ 1,4 % du PIB en France, soit dans la moyenne OCDE (1 à 1,5 % en général). Certains pays plus âgés comme les Pays-Bas y consacrent plus de 2 % du PIB, voire 3 % en Suède. Avec le vieillissement, ces dépenses vont augmenter partout. L’OCDE projette qu’entre 2015 et 2050, le nombre de personnes ayant besoin de soins de longue durée augmentera de +50 % en Europe, voire +100 % dans certains pays. En France, la part des seniors en perte d’autonomie notable pourrait passer de 3,7 % de la population en 2015 à 5,4 % en 2050. Cela représentera un défi de financement (comment payer davantage d’aides, de maisons de retraite, de personnels soignants ?) et d’organisation (système de santé à adapter, rôle des aidants familiaux). Déjà plus de 8 seniors dépendants sur 10 sont aidés de façon informelle par l’entourage, ce qui pose une charge invisible sur les familles, appelée à s’accroître.
Recettes publiques et croissance : En parallèle de ces dépenses en hausse, le vieillissement peut affecter les recettes. Si la population active stagne ou baisse, la croissance économique ralentit, donc les recettes fiscales progressent moins vite. De plus, une population âgée consomme différemment (plus de services peu taxés, moins de biens durables taxés) ce qui peut réduire certains revenus de TVA. Enfin, sur le plan des inégalités intergénérationnelles : la population âgée détient une part croissante du patrimoine et bénéficie de transferts sociaux importants, tandis que les jeunes actifs peuvent estimer contribuer beaucoup sans retour équivalent. Des think tanks comme l’Institut Montaigne ou France Stratégie ont mis en garde contre un possible déséquilibre générationnel : « 40 % à 60 % des dépenses publiques dépendent de la structure par âge de la population », rappelle un rapport, soulignant que sans ajustements, les finances publiques pourraient dériver.
Politiques de réponse : Pour faire face, plusieurs stratégies sont combinées :
- Réformes des retraites : presque tous les pays ont entrepris d’ajuster l’âge de départ et les modalités de calcul pour limiter la hausse des dépenses de pension. L’enjeu est d’ajuster paramétriquement le système pour qu’il reste soutenable malgré un ratio cotisants/retraités en baisse. Par exemple, l’Italie et la Suède ont adopté un mécanisme de calcul “notionnel” ajustant automatiquement la pension à l’espérance de vie.
- Promotion de la croissance et de l’emploi : plus d’actifs (via immigration ou taux d’activité accrus) et plus de productivité (via innovation) = plus de PIB, donc plus de base taxable pour financer les dépenses vieillissement. C’est le pari de nombreux pays de compenser la charge par un “gâteau économique” plus grand.
- Reconfiguration des dépenses : Certains pays choisissent de repenser la répartition budgétaire. Une question politique sensible est : faut-il consacrer une part toujours croissante des ressources aux aînés au risque de négliger d’autres investissements (éducation des jeunes, transition écologique) ? La “préférence pour les plus âgés” a été documentée en France : en 2016, selon une analyse, 13,6 % du PIB était dépensé pour les plus de 60 ans (retraites, santé), contre 4,6 % pour l’ensemble des moins de 25 ans (éducation principalement). Ce ratio interpelle quant à l’équité intergénérationnelle. Des économistes suggèrent qu’à l’avenir, il faudra peut-être redéployer certaines dépenses (par ex., conditionner certaines prestations seniors aux revenus, ou développer au contraire les investissements en faveur de la jeunesse pour rééquilibrer).
- Financement innovant de la dépendance : Plusieurs pays réfléchissent à des assurances publiques ou privées pour la dépendance. La France a un débat récurrent sur la création d’une “cinquième branche” de la Sécurité sociale dédiée à l’autonomie, avec un financement propre (par exemple une journée de solidarité – impôt indirect – existe depuis 2004). L’Allemagne a mis en place dès les années 1990 une assurance dépendance obligatoire. Le Japon a un système de cotisation dépendance à partir de 40 ans pour préparer le financement des soins aux très âgés. Toutes ces initiatives visent à étaler dans le temps et mutualiser le coût de la prise en charge du grand âge.
Étude de cas – protection sociale en France : France Stratégie (organisme rattaché au Premier ministre) a publié en 2020 une note intitulée « Qui paie le coût du vieillissement ? ». Elle montre qu’entre 1970 et 2020, la part des dépenses de protection sociale dans le PIB en France est passée de 20 % à 31 % du PIB, en grande partie sous l’effet du vieillissement et de l’élargissement des couvertures. Ce transfert massif de richesses vers les prestations sociales a été financé par les cotisations et impôts, c’est-à-dire principalement par les actifs. Le rapport souligne que poursuivre cette trajectoire pourrait atteindre des limites en termes d’acceptabilité et d’incitation économique. Il recommande de mieux cibler certaines dépenses (par exemple, concentrer les dépenses de santé sur la prévention dès le milieu de vie pour retarder l’apparition des dépendances) et de redistribuer différemment (par exemple, revoir les avantages fiscaux liés aux seniors aisés, sans remettre en cause la solidarité avec les retraités modestes). Ce débat rejoint la question politique plus large de la solidarité entre générations : comment maintenir un pacte social équilibré dans une société où le poids électoral et économique des seniors augmente ?
Conclusion de la section : Le vieillissement impose donc un rééquilibrage des politiques publiques. Les avantages des mesures prises sont clairs : en allongeant la vie active et en adaptant les systèmes de retraite, on partage plus équitablement l’effort et on réduit les déficits; en investissant dans la santé préventive, on peut contenir les dépenses curatives lourdes; en développant l’innovation technologique, on compense la raréfaction du facteur travail. Cependant, chaque mesure a ses limites : reporter la retraite peut être impopulaire et inégal selon les métiers; financer la dépendance nécessite de nouveaux efforts contributifs pas toujours bien acceptés; et malgré tout, une société plus âgée pourrait être moins orientée croissance (les seniors consomment moins et différemment, et votent parfois contre des réformes productives si elles menacent leurs acquis).
En fin de compte, le vieillissement n’est pas une catastrophe économique en soi, mais il oblige à adapter nos modèles sociaux : travailler plus longtemps, travailler autrement, dépenser différemment. Des choix politiques difficiles en découlent, qui devront être arbitrés de façon transparente pour maintenir la cohésion sociale entre générations.