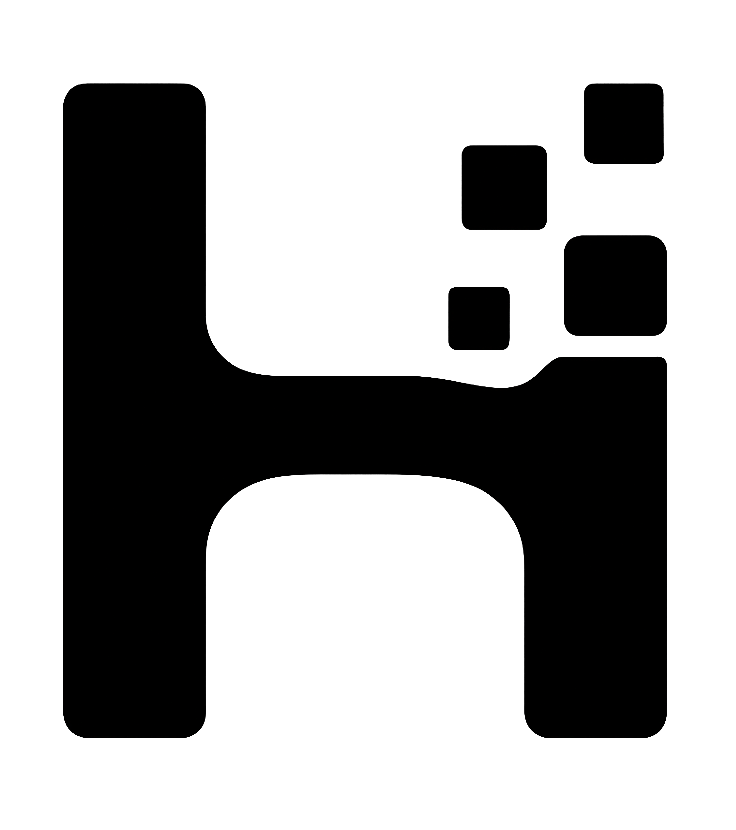Bien que représentant une part encore modeste (5 % de l’électricité en 2022), l’énergie solaire est le segment qui connaît la plus forte croissance relative ces dernières années. Cette partie se concentre sur l’évolution du photovoltaïque (PV), ses performances, ses coûts, et les perspectives à moyen terme dans le mix français. Des études de l’ADEME, de RTE, d’EY (2023) et du think tank The Shift Project (2022) serviront de référence.
Essor et trajectoires du photovoltaïque
- Capacité installée : En 2010, la France disposait d’environ 1 GW de solaire PV ; fin 2022, on avoisine les 15,7 GW de puissance cumulée. Les objectifs PPE tablent sur 40 GW d’ici 2030.
- Production : Passée de 0,8 TWh en 2010 à 22,5 TWh en 2022, soit une hausse moyenne de +25 % par an sur la dernière décennie.
- Localisation : Principalement en Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, PACA, mais la Normandie et le Grand Est progressent (mieux adaptées qu’on ne le croit grâce à la baisse du prix des panneaux).
Coûts et compétitivité
Le coût actualisé de l’électricité (LCOE) du solaire a chuté de plus de 80 % depuis 2010. En 2023, l’ADEME l’estime entre 35 et 60 €/MWh pour les grandes centrales au sol, selon les conditions d’ensoleillement et le coût du capital. Cela se rapproche du coût marginal du nucléaire historique, bien que ce dernier varie selon les centrales.
Tableau 3 : Évolution du LCOE du solaire en France (2012–2023)
| Année | LCOE estimé (€/MWh) | Facteurs clés |
|---|---|---|
| 2012 | 120 – 180 | Panneaux coûteux, subventions élevées |
| 2015 | 80 – 120 | Baisse du prix du silicium, montée en série |
| 2018 | 50 – 70 | Rendements PV améliorés, concurrence chinoise |
| 2023 | 35 – 60 | Financement à bas taux, technologies PERC¹… |
<small>¹Passivation Emitter Rear Cell, technologie de cellules plus efficaces.
Source : ADEME, IEA, compilations d’industries solaires, 2023.</small>
Défis d’intégration et stockage
Le principal inconvénient du solaire est son intermittence (production diurne et variable selon la météo). Pour soutenir l’essor du PV, la France doit :
- Développer des systèmes de stockage (batteries, pompage-turbinage hydro) ou recourir au pilotage des consommations (effacement).
- Renforcer le réseau pour absorber les pointes de production à midi et gérer les tensions locales (certains départements proches de la saturation).
- Accélérer l’autoconsommation (sur toitures résidentielles, industrielles), avec un cadre législatif favorable (loi d’autoconsommation collective 2017).
Controverses et impacts environnementaux
- Occupations de sols : Les centrales au sol peuvent entrer en concurrence avec l’agriculture ou la biodiversité. L’ADEME prône des solutions “agri-PV”, combinant cultures et panneaux surélevés.
- Recyclage des panneaux : Fin de vie d’ici 20–30 ans. Les constructeurs (Veolia, Soren) mettent en place des filières spécifiques (verre, silicium, métaux). Le taux de recyclage potentiel dépasse 90 %.
- Dépendance industrielle : La France importe l’essentiel de ses panneaux (fabrication en Chine). Les politiques récentes (stratégie REPowerEU) tentent de relocaliser une partie de la chaîne de valeur en Europe.
Résumé d’étude notable : The Shift Project, « Plan solaire pour la France » (2022) – L’étude propose un scénario de 100 GW PV d’ici 2035, appuyé sur des fermes au sol dans des friches industrielles et des toitures résidentielles. Elle conclut que l’impact carbone du solaire est amorti en seulement 2 ans d’exploitation, rendant cette technologie très rentable écologiquement. Les auteurs recommandent d’adopter une planification spatiale stricte pour éviter le mitage et la concurrence avec l’agriculture.
Perspectives : vers un solaire indispensable mais complémentaire
Le solaire devrait jouer un rôle croissant dans le mix électrique, en complément du nucléaire. Selon RTE (scénario “N03 – Nucléaire dominant”), la part du solaire pourrait atteindre 15–20 % en 2050. Sa rapidité de déploiement (2 à 3 ans pour une centrale PV) et ses coûts compétitifs en font un levier clé, notamment dans le sud de la France. En contrepartie, son pilotage exige un renforcement du stockage et des outils de flexibilité, ainsi qu’une meilleure coordination avec l’hydroélectricité et la gestion du réseau.