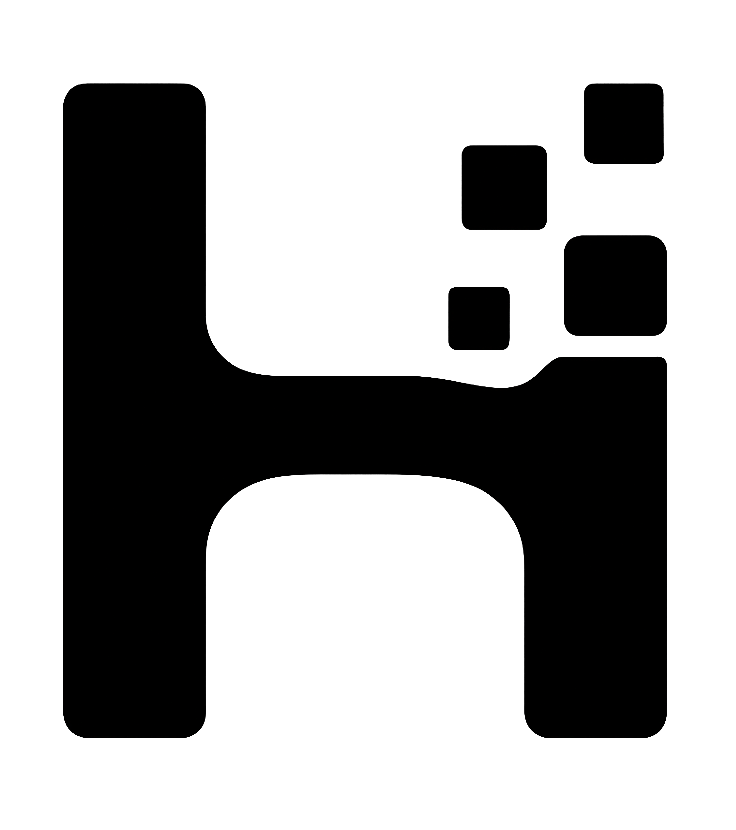Depuis le début des années 1980, la France a connu une natalité relativement stable, oscillant autour de 800 000 naissances par an. Après le baby-boom d’après-guerre (1945-1975), le nombre de naissances s’est maintenu à ce niveau avec un point bas en 1994 (741 000 naissances) et un pic en 2010 (833 000 naissances). En 2015 encore, on dénombrait environ 800 000 bébés (hors Mayotte), soit quasiment autant qu’en 2002 ou 2003. Cette stabilité s’est produite malgré la diminution du nombre de femmes de 20 à 40 ans (9,3 millions en 1995 contre 8,5 millions en 2010).
L’indicateur conjoncturel de fécondité (ICF) en France métropolitaine était d’environ 1,94 enfant par femme en 1980, puis a atteint un creux à 1,66 en 1993-1994, avant de remonter au-dessus de 1,9 dans les années 2000. Il a même franchi le seuil symbolique de 2,0 en 2006-2010 (meilleur niveau depuis 1981). Cependant, depuis 2015, une baisse se dessine : l’ICF français est passé de 2,00 en 2014 à 1,96 en 2015, poursuivant son recul pour atteindre 1,79 en 2022 puis 1,68 en 2023, un niveau historiquement bas. Selon Insee Première (S. Papon, 2024), ce taux de 1,68 enfant par femme en 2023 est le plus faible enregistré depuis la Seconde Guerre mondiale (hors creux de 1993-94). En parallèle, le nombre de naissances annuelles a chuté d’environ 20 % sur la dernière décennie, passant de 2010 à 2023 de 846 000 à 678 000 naissances. Une analyse de Maxime Sbaihi (Institut Montaigne, 2025) souligne ce “point de bascule” de la dénatalité française, avec seulement 663 000 naissances en 2023 et un taux de fécondité de 1,62 selon les données provisoires, rappelant qu’il était encore de 2,0 en 2014. Cette évolution fait renaître les inquiétudes sur le vieillissement de la population et sur la maxime de Bodin, “Il n’est de richesse que d’hommes”.
Comparaisons européennes : La France a longtemps affiché la fécondité la plus élevée de l’Union européenne. Entre 2000 et 2015, la France et l’Irlande se disputaient la première place avec un ICF proche de 1,9-2,0 chaque année. À partir de 2016 cependant, d’autres pays nordiques comme la Suède ont rejoint le peloton de tête (ICF ~1,78 en 2017), tandis que la France restait autour de 1,9. En contraste, les pays du Sud de l’Europe (Espagne, Italie, Malte, Grèce) enregistrent de longue date les ICF les plus faibles – autour de 1,2-1,3 enfant par femme ces dernières années. L’Allemagne, qui figurait il y a 15 ans parmi les pays les moins féconds (~1,3), a vu sa fécondité remonter vers 1,57 en 2017, se rapprochant de la moyenne européenne.
Au cours des 40 dernières années, la tendance générale en Europe est à la baisse puis à la stagnation de la fécondité à un niveau bas. Vers 1980, de nombreux pays européens étaient encore proches du seuil de remplacement (2,1), mais ils sont tombés en dessous dans les années 1990 : par exemple, l’Italie est passée d’environ 1,6 enfant par femme en 1980 à presque 1,2 dans les années 1995-2005. L’Espagne a connu un plancher à 1,15 vers 1995. Les pays d’Europe centrale et orientale ont vu leur fécondité chuter drastiquement après la transition des années 1990, certaines descendant sous 1,3 (ce qui définit la “très basse fécondité”). La Suède offre un profil dit en “montagnes russes” : 1,7 enfant par femme en 1980, un pic à 2,1 en 1990, rechute à 1,5 en 1999, puis retour autour de 1,9 en 2010, illustrant l’impact des cycles économiques et des politiques familiales sur la natalité.
Données récentes (2022-2023) : La pandémie de COVID-19 a eu des effets contrastés sur la natalité en Europe, avec parfois un “baby-blip” en 2021 suivi d’un recul. En 2022, environ 3,9 millions d’enfants sont nés dans l’UE, mais ce nombre a chuté à 3,67 millions en 2023, soit une baisse de –5,4 % en un an. Eurostat rapporte qu’il s’agit de la plus forte diminution annuelle des naissances enregistrée depuis 1961 en Europe. Le taux de fécondité moyen de l’UE a ainsi reculé de 1,46 à 1,38 enfant par femme entre 2022 et 2023. La France demeure en 2023 l’un des pays les plus féconds de l’UE avec 1,66 enfant par femme (donnée Eurostat) – seul le Bulgaria la dépasse à 1,81, aidée par une politique nataliste récente. À l’inverse, des pays comme Malte (1,06), Espagne (1,12) ou Italie (~1,25) figurent parmi les plus bas au monde. L’Irlande et la Suède se maintiennent autour de 1,7, tandis que l’Allemagne et le Royaume-Uni sont autour de 1,5–1,6 (après une remontée par rapport aux creux des années 1990). Ces écarts reflètent des différences culturelles, socio-économiques et de politiques publiques que nous analyserons dans la partie suivante.
Résumé d’étude notable : Observatoire Sociétal (X. Niel, 2023) – « La fécondité est stable depuis 40 ans en France » – Cette étude souligne la grande stabilité de l’ICF français entre 1,8 et 2,0 depuis les années 1970. Malgré des oscillations annuelles, la France présente une exception relative dans le paysage européen de la faible fécondité. L’auteur attribue cette performance à un modèle social français qui a su atténuer le coût d’un enfant pour les familles (allocations, services de garde) et à un certain optimisme socio-économique des trentenaires en France par rapport à leurs voisins. Toutefois, l’étude note qu’après 2015, la France n’est pas immunisée contre la dégradation observée ailleurs, d’où la nécessité de renforcer les soutiens aux jeunes parents.
Tableau : Indicateur de fécondité (enfants par femme) – Évolution 1980–2023 (sélection de pays)
| Pays | ~1980 | ~2000 | 2010 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| France | 1,95 | 1,88 | 2,00 | 1,79 | 1,68 |
| Allemagne (ex-Ouest) | 1,45¹ | 1,38¹ | 1,39 | 1,58 | ~1,50 |
| Italie | 1,64¹ | 1,26 | 1,45 | 1,25 | 1,30 (est.) |
| Suède | 1,68¹ | 1,54 | 1,98 | 1,67 | ~1,58 |
| UE-27 moy. | ~1,85² | 1,45 | 1,62 | 1,46 | 1,38 |
<small>Sources : Données historiques Insee, Eurostat, ONU. ¹Estimations ONU (World Population Prospects). ²EU à 27 estimée en 1980, données partielles.</small>
En résumé, la France a mieux résisté que ses voisins au recul de la fécondité depuis 1980, grâce à une combinaison de facteurs socio-politiques favorables. Néanmoins, la tendance récente à la baisse alerte sur la fragilité de cet acquis. L’Europe dans son ensemble est engagée depuis les années 1990 dans une ère de fécondité durablement basse, en deçà du seuil de renouvellement des générations, posant le défi d’un déséquilibre démographique croissant.