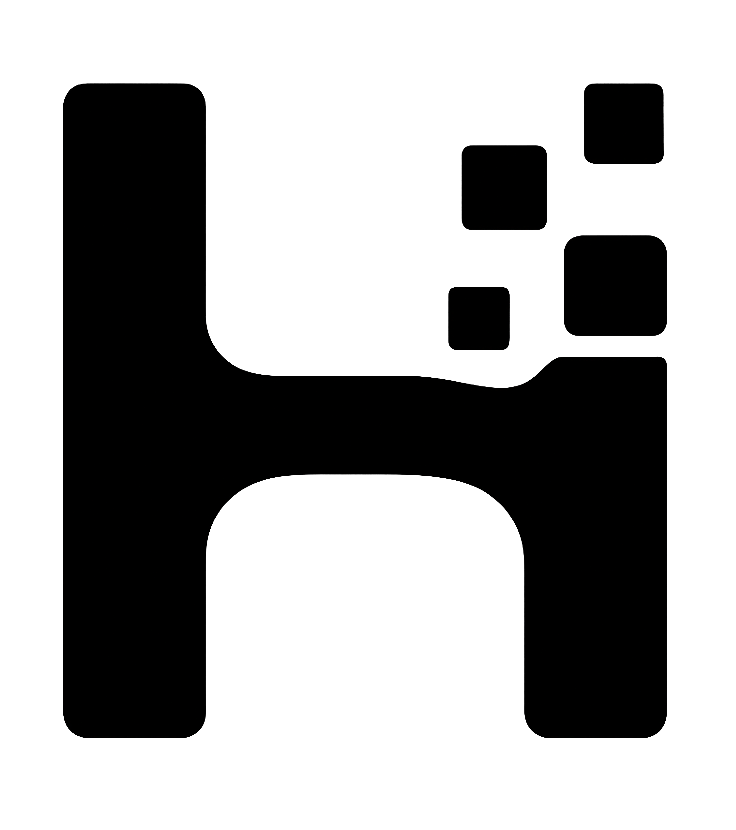Le nucléaire constitue l’épine dorsale de la production électrique française bas-carbone, avec environ 56 réacteurs en exploitation (avant fermetures programmées ou prolongations). Cette section fait un focus détaillé : historique de développement, état actuel, enjeux de maintenance, et perspectives (EPR, SMR, réformes possibles). Nous nous appuierons sur des études récentes de la Cour des Comptes (2022), de l’Agence internationale de l’énergie (2023), de l’OCDE/NEA et de think tanks français (Institut Montaigne, The Shift Project).
Genèse et développement du parc : 1970–2000
- Programme Messmer (1974) : lancé après le premier choc pétrolier, il visait l’indépendance énergétique via la construction en série de réacteurs à eau pressurisée (REP). En 15 ans, la France a édifié près de 40 réacteurs.
- Puissance installée : Le parc a atteint un pic de 63 GW nucléaires dans les années 1990, représentant jusqu’à 75–80 % de la production électrique.
- Excellence industrielle : EDF et Framatome (puis Areva) sont devenus leaders mondiaux de la technologie REP, exportant leur savoir-faire en Chine, en Afrique du Sud, etc.
État actuel : performances, maintenance et enjeux de sûreté
En 2022, seuls 32 à 38 réacteurs sur 56 étaient régulièrement en fonctionnement nominal, plusieurs étant à l’arrêt pour des vérifications de corrosion sous contrainte ou pour des opérations de maintenance approfondie. Cela a entraîné :
- Une baisse de la production nucléaire à 279 TWh (au lieu des ~360–380 TWh habituels).
- Un appel accru au gaz et à l’importation (depuis l’Allemagne, la Belgique, etc.).
Tableau 2 : Disponibilité du parc nucléaire en France (2022)
| Réacteurs | Nombre total | Taux de disponibilité moyen¹ | Observations |
|---|---|---|---|
| 900 MW (32 tranches) | 32 | ~70 % | Parc le plus ancien (années 80) |
| 1300 MW (20 tranches) | 20 | ~63 % | Problèmes de corrosion |
| 1450 MW (4 tranches) | 4 | ~55 % | Maintenances prolongées |
| Total | 56 | ~64 % | En baisse par rapport à 2021 |
<small>¹Taux de disponibilité = proportion de temps où le réacteur est en fonctionnement effectif à pleine charge.
Sources : EDF, RTE, compilation 2023.</small>
Sûreté : L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) souligne la nécessité de renforcer la surveillance des phénomènes de vieillissement, de revisiter certains circuits (soudure, circuits de refroidissement) et de procéder à des troisièmes visites décennales approfondies. Les dépenses de maintenance sont en hausse (25 milliards € annoncés pour la période 2022–2030).
Le débat sur la prolongation vs. renouvellement
- Prolonger jusqu’à 50 ou 60 ans ? Le gouvernement a exprimé sa volonté de prolonger au maximum les centrales, sous réserve de l’avis de l’ASN. Les études de l’IRSN (2023) confirment la faisabilité technique pour certaines tranches, moyennant des investissements importants.
- Nouvelle vague de constructions : Annoncée par le Président de la République en 2022, elle consiste en la construction de 6 nouveaux EPR2 sur la période 2035–2050, voire 8 supplémentaires si la demande électrique croît fortement (scénario RTE “Futurs Énergétiques 2050”).
- Coûts et financement : Selon la Cour des Comptes (rapport 2022), le coût unitaire d’un EPR2 pourrait osciller entre 7 et 8 milliards € par réacteur, hors aléas. Le financement ferait appel à la fois à EDF, à des garanties publiques et éventuellement à des investisseurs privés (dette obligataire).
Résumé d’étude notable : Institut Montaigne, « L’avenir du nucléaire civil français » (2023) – Les auteurs insistent sur la nécessité d’une planification stable pour éviter les oscillations politiques (entre fermeture et relance). L’étude conclut que le nucléaire restera, à horizon 2050, l’axe majeur pour assurer un socle de production stable, avec 50 à 55 % du mix électrique si la France veut soutenir l’électrification massive (véhicules, chauffage), tout en maîtrisant les coûts.
Critiques et limites : délais, sûreté, déchets
- Délais de construction : L’EPR de Flamanville accumule 12 ans de retard et un surcoût énorme (de 3,3 à plus de 13 milliards €). C’est un argument pour les opposants, qui estiment le nucléaire “inconstructible dans les temps impartis au défi climatique”. EDF répond qu’il s’agit d’un prototype et que les EPR2, rationalisés, seront plus rapides et moins coûteux.
- Acceptabilité et sûreté : Accidents passés (Tchernobyl, Fukushima) ont marqué l’opinion. En France, la majorité reste globalement favorable au nucléaire (56 % en 2023 selon un sondage IFOP), mais des inquiétudes persistent quant à la gestion des risques et des déchets (projet CIGÉO à Bure).
- Gestion des déchets : L’ANDRA assure qu’un stockage géologique profond (CIGÉO) est la solution la plus sûre pour les déchets de haute activité. La mise en service prévue vers 2035–2040 fait toujours l’objet de controverses locales et environnementales.
Conclusion sur le nucléaire : Malgré les défis techniques, financiers et sociaux, le nucléaire demeure le pilier principal de l’électricité française bas-carbone. Les études convergent sur la nécessité de pérenniser une base nucléaire (au moins 40–50 GW) pour garantir la sécurité d’approvisionnement et la compétitivité, tout en gérant mieux les aléas industriels. Les deux sections suivantes traiteront du solaire (Partie 3) et de l’hydraulique (Partie 4) en complément de ce socle nucléaire.