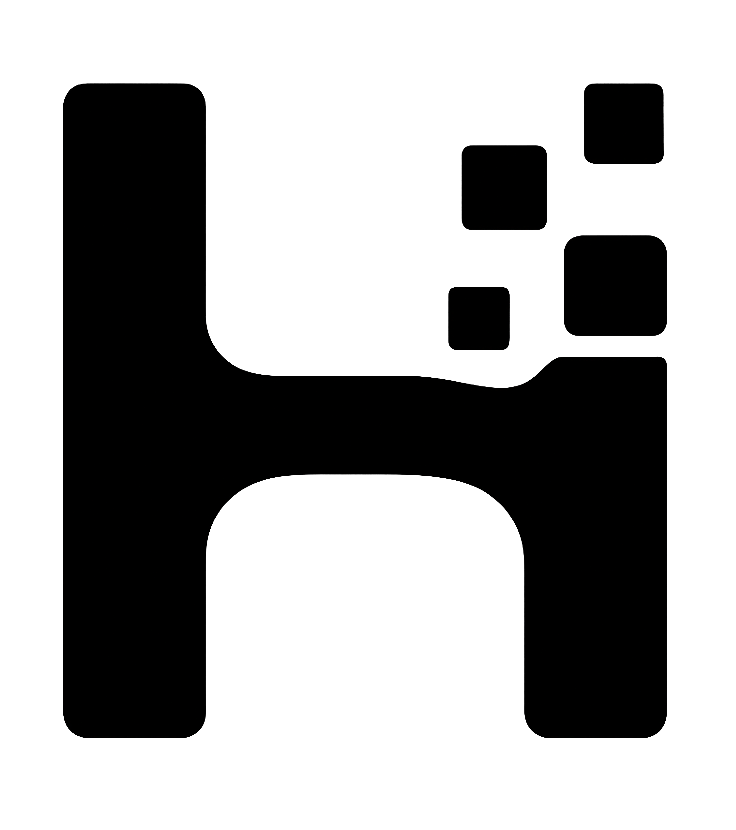Le vieillissement démographique – c’est-à-dire l’augmentation de la part des personnes âgées dans la population – est une tendance mondiale inéluctable des prochaines décennies. Cette section présente les projections à l’horizon 2050 pour plusieurs pays clés, en s’appuyant sur les données des Nations unies (World Population Prospects 2022), de l’OCDE et des instituts nationaux (Insee, Statistique Canada, etc.). Nous examinons notamment l’évolution de la part des seniors (65 ans et +), de l’âge médian et du ratio de dépendance (rapport des populations âgées aux populations en âge de travailler), afin de comparer l’ampleur du vieillissement en France, en Europe et ailleurs. Nous analyserons également les facteurs explicatifs (faible natalité, allongement de la vie) et les incertitudes qui entourent ces projections (rôle de l’immigration, scénarios hauts et bas).
Tendances globales : un doublement des seniors dans le monde d’ici 2050
Au niveau mondial, la population des 65 ans et plus va plus que doubler entre 2020 et 2050, passant d’environ 700 millions à 1,5 milliard de personnes âgéesined.fr. Leur part dans la population mondiale passera d’environ 9 % à 16 %ined.fr. Autrement dit, en 2050, près d’une personne sur six sur la planète sera un senior. Ce phénomène est particulièrement prononcé dans les pays développés et certaines régions d’Asie. Les Nations unies soulignent qu’il s’agit d’un changement de structure sans précédent historique, conséquence simultanée de la baisse de la fécondité et de l’augmentation de l’espérance de vie. À l’échelle de l’Europe et de l’Amérique du Nord, on estime qu’en 2050 environ 27 % de la population aura plus de 65 ans.
France : un vieillissement réel mais modéré en comparaison
La France métropolitaine, grâce notamment à sa fécondité relativement élevée du passé et à une immigration modérée, aura en 2050 une structure moins âgée que nombre de ses voisins. Selon l’Ined (projections médianes ONU 2019), la part des personnes 65 ans et plus en France métropolitaine passerait d’environ 21 % en 2020 à 28 % en 2050. Autrement dit, un peu plus d’un Français sur quatre sera âgé de 65+ en 2050. C’est un vieillissement marqué (en 1980 cette part n’était que ~14%), mais la France ne ferait pas partie des pays les plus âgés. La raison en est qu’elle conserverait des effectifs de jeunes relativement plus importants que ses voisins, grâce à une natalité moins basse historiquement.
En nombre absolu, la France pourrait compter autour de 20 millions de personnes de 65 ans et plus en 2050, contre ~13,5 millions en 2020 (estimation Insee). Le ratio de dépendance des personnes âgées (nombre de 65+ pour 100 personnes de 20-64 ans) augmenterait fortement, passant d’environ 33 en 2020 à 50 en 2050 (c’est-à-dire deux actifs pour un senior). L’Insee anticipe par ailleurs que l’espérance de vie continue de progresser (malgré un plateau pendant la crise Covid) pour atteindre vers 2050 environ 88 ans pour les femmes et 84 ans pour les hommes, ce qui amplifiera le nombre de très âgés (80 ans et +). Cette classe des grands aînés est celle qui croîtra le plus vite : les projections suggèrent plus de 4,8 millions de personnes de 80+ en 2050 en France, contre ~2,5 millions en 2020.
Il convient de noter que ces projections peuvent varier selon les hypothèses de fécondité et de migration. Si la fécondité française rebondissait vers 1,9 ou 2,0 dans les décennies à venir (scénario optimiste), le vieillissement serait un peu moins prononcé (peut-être 26 % de seniors au lieu de 28 %). À l’inverse, une poursuite de la baisse vers 1,6 ou moins accentuerait la part des seniors. De même, une immigration nette plus forte pourrait rajeunir légèrement la population (les migrants étant généralement jeunes). Nous aborderons ce levier en section 5.
Allemagne et Europe du Sud : un vieillissement plus accentué
L’Allemagne, qui a longtemps eu l’une des fécondités les plus faibles d’Europe (1,3 dans les années 1980-90), est engagée dans un vieillissement rapide. En 2050, la part des 65+ en Allemagne atteindrait environ 32 à 34 % (projections ONU). Déjà en 2022, l’Allemagne a le plus haut âge médian d’Europe (~46 ans). D’ici 2050, sa population totale pourrait décliner (passant de 83 à ~75-80 millions selon l’immigration). Le ratio de dépendance pourrait avoisiner 60 seniors pour 100 actifs.
Les pays d’Europe du Sud – Italie, Espagne, Grèce, Portugal – connaîtront parmi les plus fortes proportions de personnes âgées au monde. Leur faible natalité persistante (souvent <1,4) et une espérance de vie élevée aboutissent à une projection de 36 % de 65+ en 2050 dans le sud de l’Europe. Par exemple, l’Italie (60 millions d’habitants aujourd’hui) pourrait voir sa population chuter sous 54 millions et compter plus d’un tiers de seniors. L’Espagne passerait d’environ 19 % de seniors en 2020 à 32-34 % en 2050. Ces pays seront confrontés à un déclin de population active particulièrement sévère, ayant peu recours à l’immigration jusqu’à récemment.
Un indicateur marquant est l’âge médian (âge qui partage la population en deux moitiés). En Italie, l’âge médian pourrait passer de 45 ans aujourd’hui à plus de 53 ans en 2050 (source : Eurostat/ONU). Cela signifie qu’en 2050, la moitié des Italiens auront plus de 53 ans – un niveau de maturité démographique extraordinaire. Par comparaison, l’âge médian français serait d’environ 44-45 ans en 2050 (contre 41 en 2020).
Japon : le doyen des nations
Le Japon est souvent cité comme le précurseur du vieillissement extrême. Sa population est déjà en déclin depuis 2010 (127 millions alors, ~124 millions en 2022). Avec une fécondité très basse (~1,3) et une des plus grandes longévités au monde (85+ ans), le Japon va voir sa structure se déséquilibrer fortement. En 2020, 28 % des Japonais avaient 65 ans ou plus. En 2050, cette proportion atteindrait environ 38 %. Des projections nationales japonaises indiquent qu’au-delà, on pourrait frôler les 40 % en 2065-2070. Déjà aujourd’hui, le Japon compte près de 86 000 centenaires. En 2050, la population japonaise pourrait ne plus compter que 105 millions d’habitants ou moins, soit une chute de 15% en 30 ans, dont l’essentiel chez les actifs et les jeunes. Le ratio de dépendance personnes âgées exploserait à près de 80 % (presque un actif pour un retraité) vers 2050. Cela pose des défis immenses pour le système de protection sociale japonais, d’où les réformes déjà en cours (repousser l’âge de la retraite, robotisation des soins, encouragement de l’immigration ciblée). À noter, la Corée du Sud devrait rejoindre le Japon dans ces records de vieillissement : partie de beaucoup plus bas en 1950, elle pourrait devenir en 2050 le pays le plus âgé au monde, aux côtés du Japon, avec également près de 38 % de seniors.
Canada : un pays occidental relativement jeune grâce à l’immigration
Le Canada présente un contraste intéressant. Actuellement, environ 18,9 % de sa population a 65 ans ou plus (en 2023)www150.statcan.gc.ca. Ce niveau, proche de celui de la France, va augmenter d’ici 2050, mais le Canada mise sur une immigration soutenue pour atténuer le vieillissement. Statistique Canada projette qu’en 2043 la proportion de seniors pourrait atteindre entre 23 % et 25 % selon les scénarios moyens, et en 2070 entre 26 % et 32 %www150.statcan.gc.ca. En 2050, on peut estimer qu’environ un quart des Canadiens seront âgés, un niveau un peu inférieur à l’Europe grâce à une fécondité légèrement plus élevée que l’Europe (1,5 enfant/femme ces dernières années au Canada contre 1,3 en Europe du Sud) et surtout grâce à un afflux migratoire qui rajeunit la pyramide des âges. Le gouvernement canadien a d’ores et déjà annoncé des objectifs d’immigration records (500 000 immigrants par an d’ici 2025) pour compenser le faible accroissement naturel. Si ces politiques se poursuivent, la population totale du Canada continuera de croître (de 38 millions en 2020 à possiblement 45-50 millions en 2050), maintenant un ratio de remplacement un peu plus favorable que dans les pays sans immigration. Néanmoins, même au Canada, le ratio de dépendance personnes âgées devrait passer d’environ 30 (en 2020) à plus de 45 en 2050, traduisant un alourdissement de la charge sur la population active.
Autres exemples : cas notable de la Chine et divergence Nord-Sud
Il convient de mentionner brièvement deux tendances globales :
- Chine : Avec la fin du “dividende démographique”, la Chine vieillit à un rythme accéléré. Le pays a enregistré en 2022 sa première baisse de population depuis des décennies. En 2050, près de 30 % de la population chinoise (qui pourrait avoisiner 1,3 milliard) aura plus de 60 ans. La politique de l’enfant unique du passé, suivie d’une fécondité durablement faible (~1,2-1,3), fait que la Chine aura une structure proche de celle de l’Europe en 2050, avec un très grand nombre de personnes âgées à prendre en charge. C’est un défi majeur compte tenu du niveau de vie encore intermédiaire de la Chine (on parle parfois de “vieillir avant de s’enrichir”).
- Afrique et Moyen-Orient : À l’inverse, certaines régions du monde conserveront une population très jeune en 2050. L’Afrique subsaharienne en particulier aura encore un âge médian proche de 25-30 ans en 2050 (contre >45 en Europe). Des pays comme le Nigeria ou la République Démocratique du Congo auront une base de jeunesse très large (fécondité encore autour de 3-4). Cette divergence Nord-Sud pose des enjeux migratoires et économiques globaux : l’offre de main-d’œuvre jeune sera abondante dans certaines régions alors que la demande de travailleurs sera forte dans les pays vieillissants – un déséquilibre que seule la migration ou la délocalisation des activités pourrait compenser.
Tableau : Part projetée des personnes âgées de 65 ans et plus (%) en 2050
| Pays/Zone | 1980 | 2020 | 2050 (proj.) |
|---|---|---|---|
| France | 13 % | 20 % | 28 % |
| Allemagne | 15 % | 22 % | 32-34 % (est.) |
| Italie | 14 % | 23 % | 36 % |
| Japon | 9 % | 28 % | 38 % |
| Canada | 10 % | 18 % | 25 % (est. scénario moyen) |
| États-Unis | 11 % | 17 % | 22 % (est.) |
| UE-27 moyenne | 14 % | 20 % | 27-30 % (est.) |
| Monde | 5 % | ~9 % | 16 %ined.frined.fr |
| <small>Sources : Division de la Population de l’ONU (WPP 2022), OCDE, instituts statistiques nationaux. </small> |
Ces chiffres soulignent l’ampleur du défi à venir, en particulier pour les pays d’Europe et d’Asie de l’Est. La France se situe dans une position intermédiaire, connaissant un vieillissement certain mais moins aigu que ses voisins du sud et de l’est. Le Japon et la Corée du Sud seront à l’extrême, avec environ 3 personnes sur 8 de plus de 65 ans. Le Canada et les États-Unis vieilliront également, mais un peu moins grâce à l’immigration et une fécondité légèrement plus élevée (aux USA, ~1,7-1,8 ces dernières années). Enfin, le contraste Nord-Sud nous rappelle que le vieillissement est une question géopolitique autant que démographique : il y aura des excédents de jeunes dans certains pays et des pénuries dans d’autres, posant la question des migrations internationales et de la coopération (voir partie 5).
Synthèse des causes du vieillissement et incertitudes des projections
Le vieillissement en cours résulte de deux phénomènes bien connus : la baisse de la natalité (depuis les années 1970, presque tous les pays sont passés en dessous du seuil de remplacement, ce qui réduit l’apport de jeunes générations) et la hausse de l’espérance de vie (les générations du baby-boom vivent plus longtemps, gonflant les rangs des seniors). Par exemple, en France, l’espérance de vie à la naissance a gagné environ 10 ans depuis 1980, atteignant 85,7 ans pour les femmes et 80 ans pour les hommes en 2023. Cette longévité accrue est évidemment une réussite en soi, mais conjuguée à la faible fécondité, elle modifie profondément la pyramide des âges.
Les projections à 2050 sont robustes pour les 20 prochaines années (car les personnes qui auront 65 ans en 2040 sont déjà nées), mais elles comportent des incertitudes à plus long terme. Un facteur clé sera l’évolution éventuelle de la fécondité : un rebond (par exemple via de nouvelles politiques familiales efficaces) pourrait ralentir le vieillissement après 2040, alors qu’une chute supplémentaire (par ex. effets durables de la crise climatique ou autres) l’accentuerait. L’immigration joue aussi un rôle de variable d’ajustement : les pays qui accueilleront des migrants jeunes en nombre significatif atténueront la hausse du ratio de dépendance, tandis que ceux qui restent fermés connaîtront un choc plus brutal sur leur population active. Enfin, l’espérance de vie elle-même n’est pas figée : elle pourrait progresser plus vite que prévu (technologies médicales) et augmenter encore la proportion de très âgés, ou au contraire stagner en raison de crises sanitaires ou d’inégalités de santé.
En somme, à politiques inchangées, les décennies à venir verront une hausse sans précédent du poids des seniors, particulièrement dans les économies avancées. Cela aura d’importantes conséquences économiques et sociales, en termes d’emploi, de productivité et de finances publiques.