Résumé exécutif
Depuis trois décennies, la France a structuré sa politique économique autour du paradigme de la “croissance à la frontière technologique”, inspiré des travaux de Philippe Aghion et fondé sur la dynamique schumpétérienne de l’innovation et de la destruction créatrice.
Ce cadre théorique, pertinent pour des économies déjà consolidées technologiquement, a toutefois pu être appliqué de manière prématurée à la France — une nation dont la base productive s’est affaiblie et dont la souveraineté industrielle, énergétique et numérique s’est progressivement érodée.
Dans un monde confronté aux impératifs écologiques, à la relocalisation des chaînes de valeur et à la fragmentation géopolitique, la France doit désormais assumer un positionnement de rattrapage industriel durable, conciliant productivité, souveraineté et soutenabilité environnementale.
1. Un diagnostic à revisiter
Le paradigme “aghionien” repose sur trois leviers :
- la concurrence comme moteur de productivité,
- la mobilité et la prise de risque comme vecteurs d’innovation,
- la destruction créatrice comme processus de renouvellement économique.
Mais ce modèle suppose un capital technologique et industriel dense. Or, la France connaît aujourd’hui :
- une part de l’industrie passée de 25 % à 10 % du PIB,
- une stagnation de la productivité depuis vingt ans,
- une forte dépendance technologique vis-à-vis des importations (90 % des robots industriels, 100 % des GPU).
La France n’évolue donc pas “à la frontière”, mais dans une phase de rattrapage productif.
Une erreur de diagnostic conduit à appliquer des outils de compétitivité “libéralisante” à une économie qui n’a plus de socle industriel stable.
2. Un cadre européen à contre-temps
Les politiques européennes ont souvent promu la concurrence interne, la libéralisation des échanges et la neutralité de l’État investisseur, des principes adaptés à un marché intégré, mais parfois inadaptés à un continent en déficit de souveraineté industrielle et énergétique.
Les efforts récents en faveur du Green Deal, du Net Zero Industry Act et du Chips Act vont dans le bon sens, mais restent encore trop dispersés et sous-dotés pour constituer une stratégie de rattrapage cohérente.
La “French Tech” a généré un écosystème entrepreneurial dynamique, mais principalement orienté vers les services numériques, souvent dépendants de serveurs, plateformes et composants extra-européens.
La transition écologique et la souveraineté numérique exigent au contraire une base industrielle locale, sobre, circulaire et résiliente.
3. Leçons internationales : l’exemple asiatique
L’expérience des pays d’Asie de l’Est montre qu’un rattrapage industriel rapide peut s’articuler avec une stratégie étatique volontariste :
- protection temporaire du marché intérieur,
- transferts technologiques encadrés,
- crédit public orienté vers la production,
- massification de la formation technique.
Ces politiques, combinées à une montée progressive en gamme, ont permis la constitution d’un tissu industriel capable ensuite de rivaliser par l’innovation.
Aujourd’hui, la Chine et la Corée du Sud réorientent d’ailleurs leurs industries vers une croissance plus verte, intégrant efficacité énergétique, recyclage et innovation bas-carbone.
4. Trois leviers pour une stratégie française de reconstruction productive et durable
1. Accélérer les transferts technologiques responsables
Faciliter l’accès, le rachat ou la licence de technologies stratégiques étrangères (IA, semi-conducteurs, robotique, énergie), tout en intégrant des clauses de soutien à la durabilité : efficacité énergétique, recyclabilité, réduction des émissions industrielles.
→ Objectif : rattraper dix ans de retard technologique tout en inscrivant la réindustrialisation dans les limites planétaires.
2. Créer une demande intérieure verte et souveraine
Utiliser la commande publique pour soutenir des filières nationales dans la santé, l’éducation, la défense, l’énergie propre, le cloud et les mobilités électriques.
→ L’État et les grands groupes doivent devenir les premiers clients du “Made in France responsable”.
Chaque euro public investi devrait renforcer à la fois la compétitivité industrielle et la transition écologique.
3. Subventionner la production, l’énergie et la formation durable
Investir massivement dans le capital physique et humain :
- usines bas-carbone et compute centers alimentés en nucléaire et renouvelable,
- infrastructures énergétiques à faible empreinte,
- formation d’ingénieurs et de techniciens dans les métiers de l’industrie verte et de l’automatisation.
→ Créer des zones franches technologiques durables, avec réglementation simplifiée, fiscalité incitative, et standards RSE exigeants.
5. Conclusion : un projet de souveraineté durable
La réindustrialisation française ne peut être un simple retour au passé productiviste.
Elle doit combiner trois impératifs : compétitivité, soutenabilité, souveraineté.
Il s’agit moins de reproduire la Silicon Valley que de bâtir une Europe de la production décarbonée, capable d’innover, de produire et de recycler sur son propre sol.
L’objectif d’ici 2040 :
- Doubler la productivité manufacturière,
- Diviser par deux le coût énergétique et l’empreinte carbone de la production,
- Retrouver la maîtrise technologique sur les filières critiques,
- Former une nouvelle génération d’ingénieurs, techniciens et entrepreneurs ancrés dans l’économie réelle.
Synthèse :
La France n’est pas condamnée au déclin industriel, mais elle ne peut ignorer sa position réelle dans le cycle mondial de l’innovation.
Pour redevenir une nation de frontière technologique, elle doit d’abord redevenir une nation qui produit — proprement, localement, durablement.
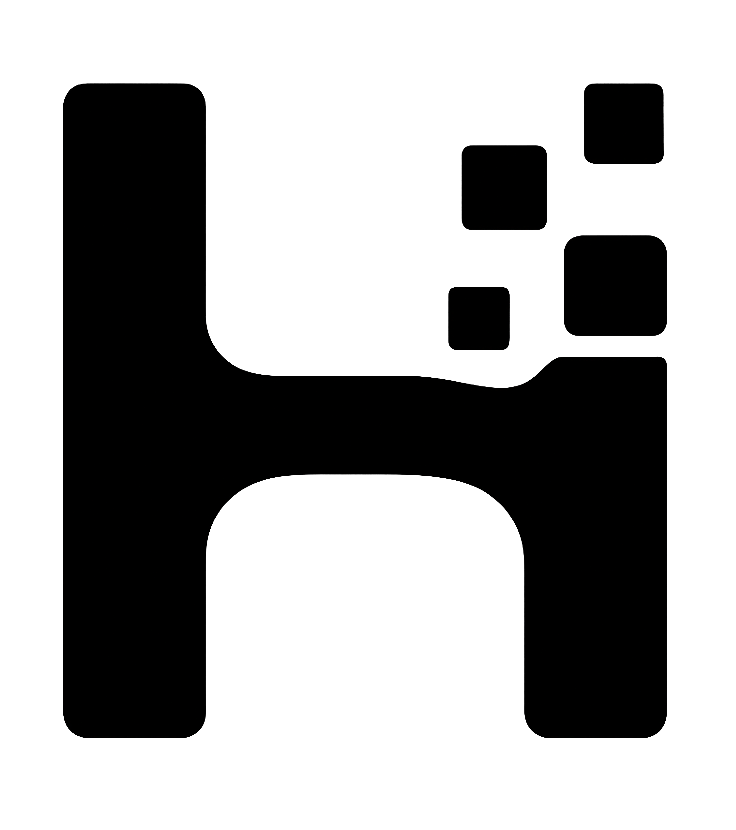
Laisser un commentaire